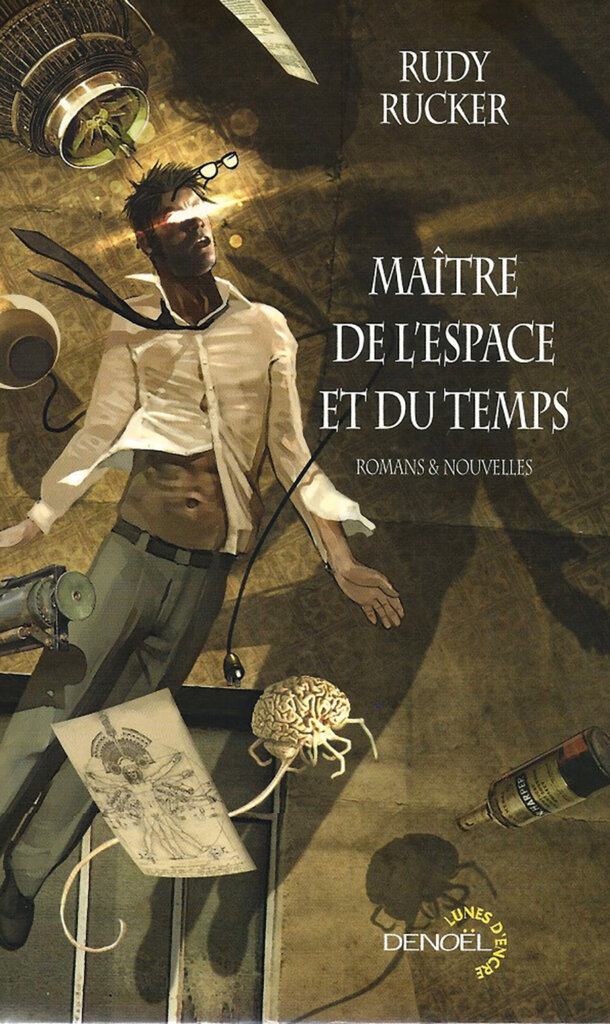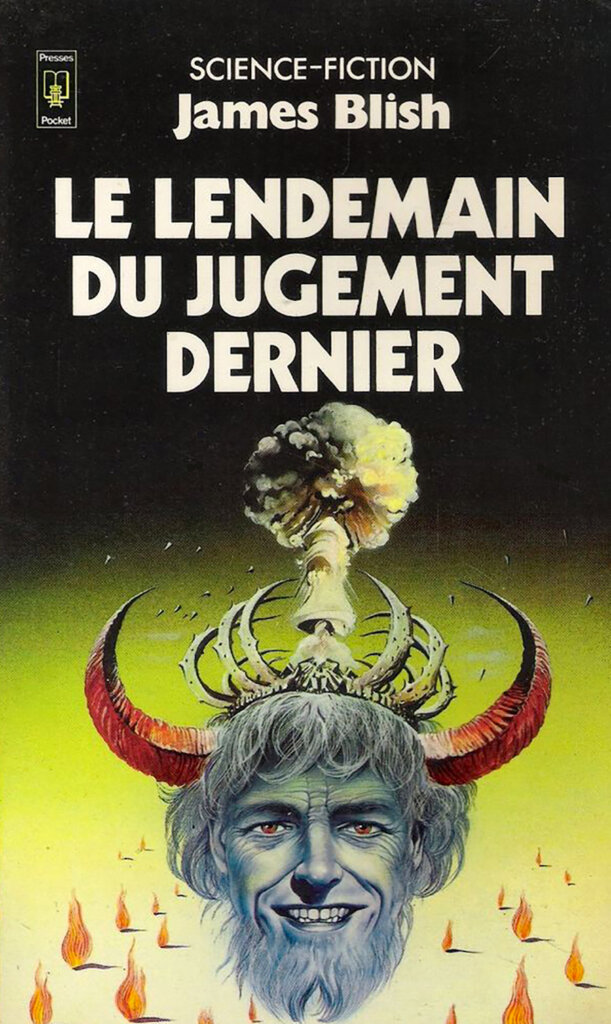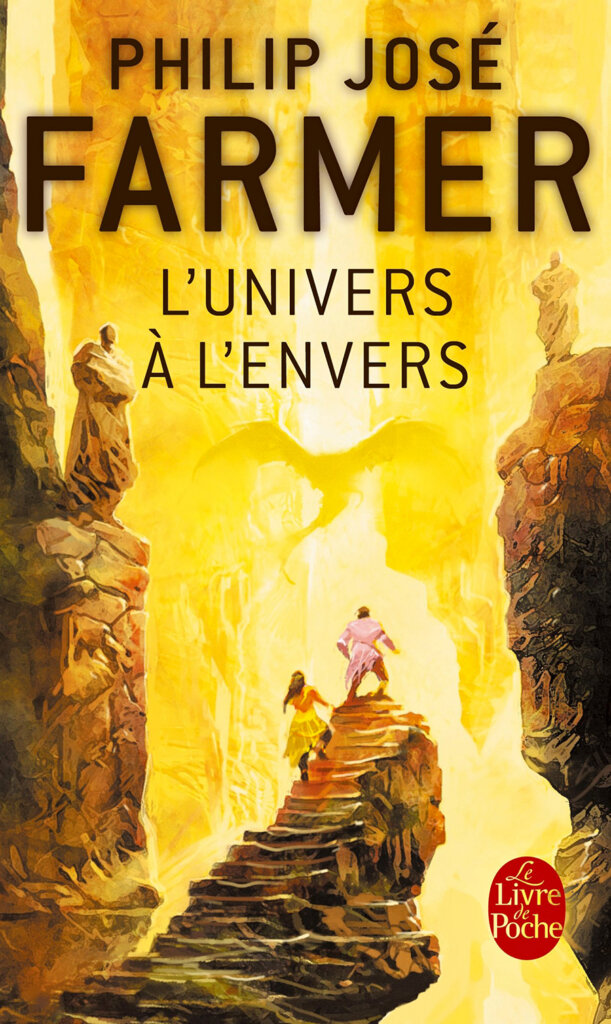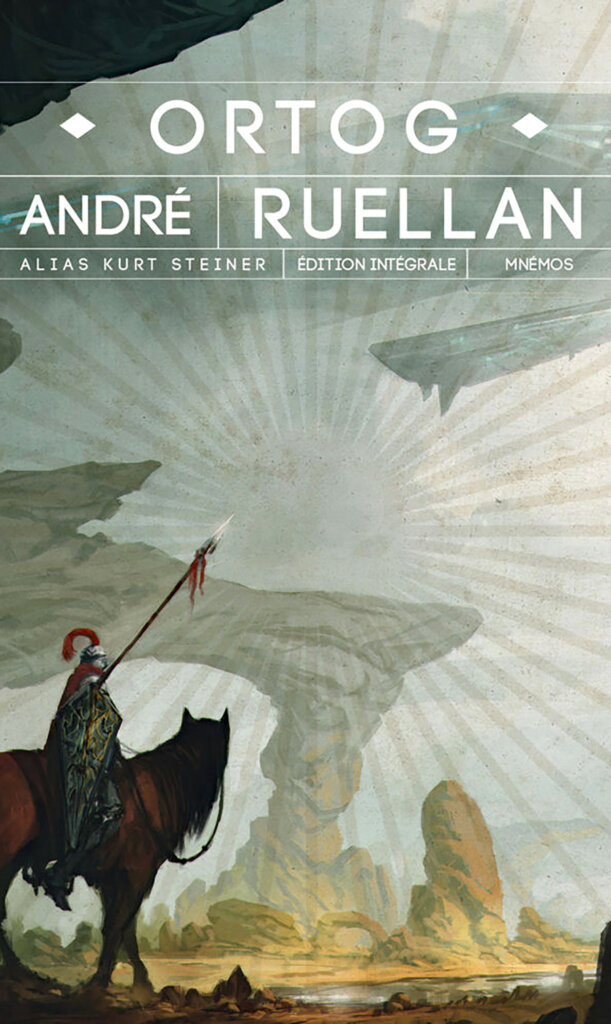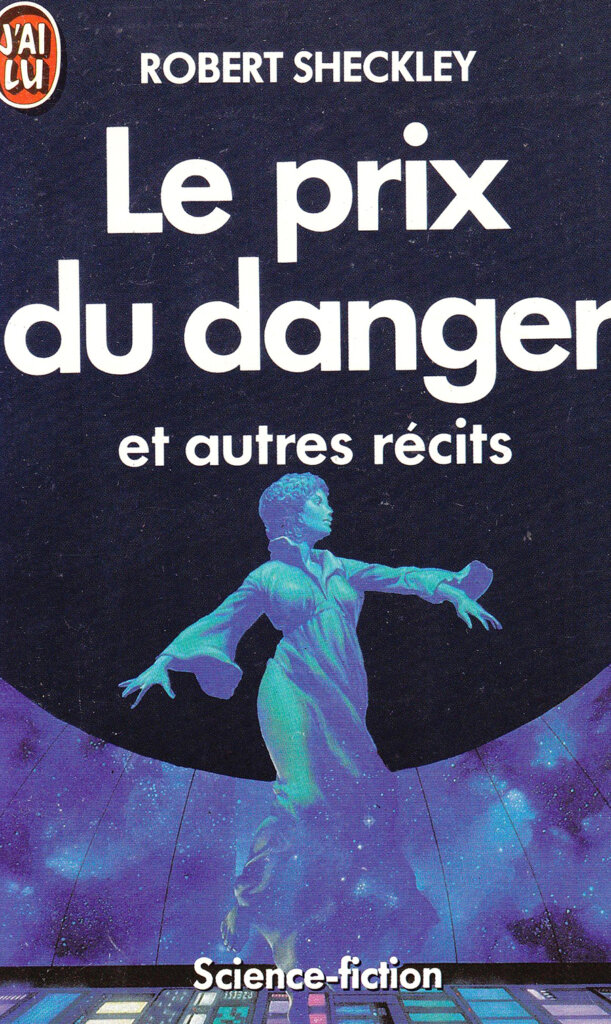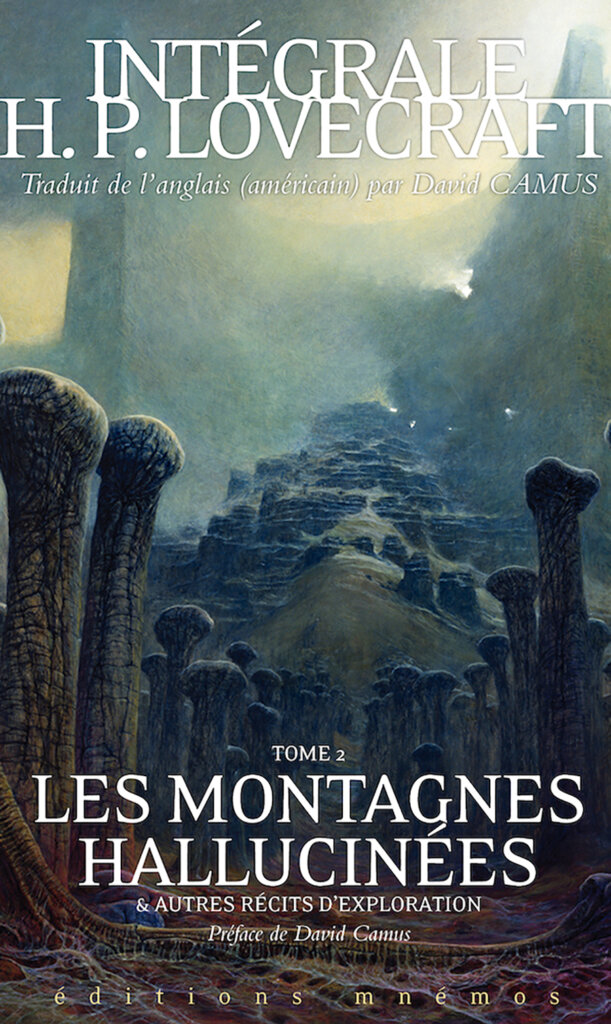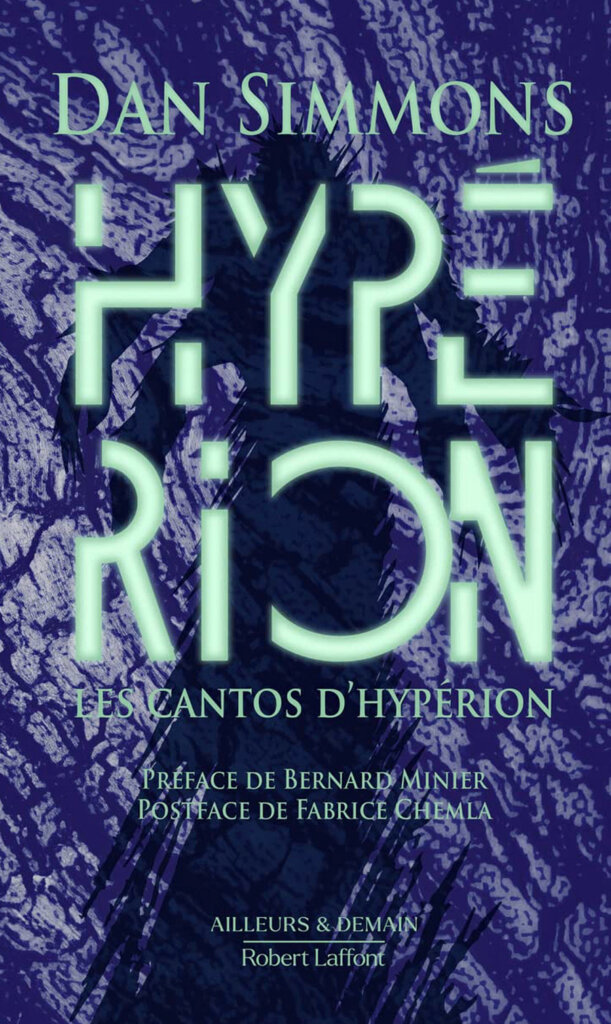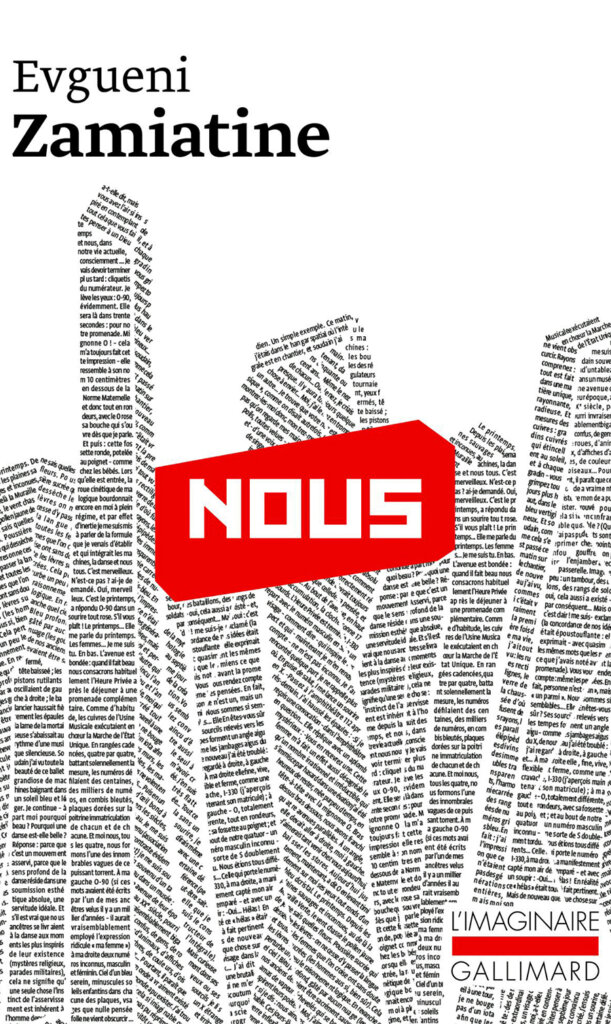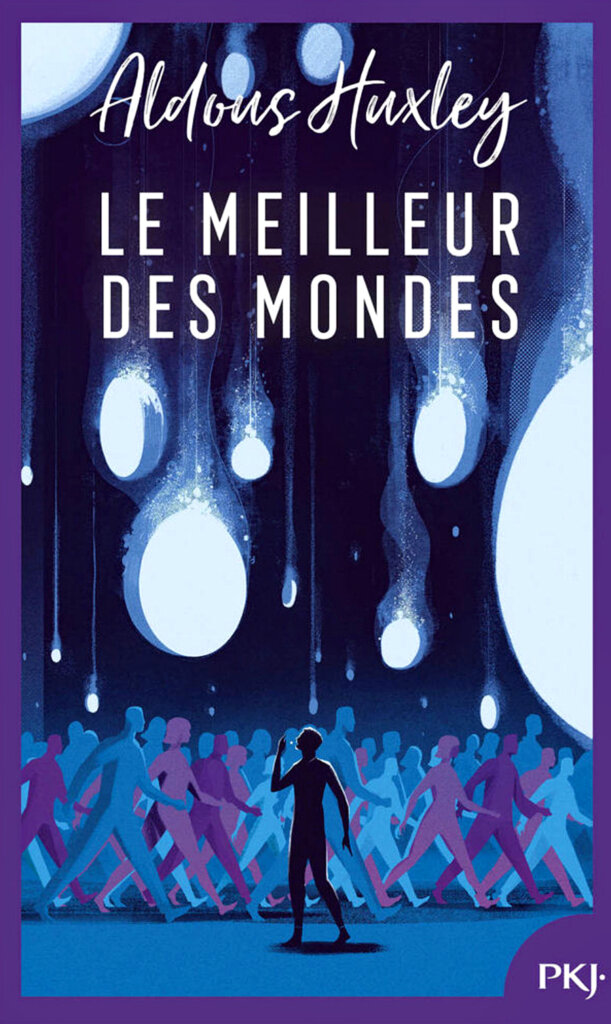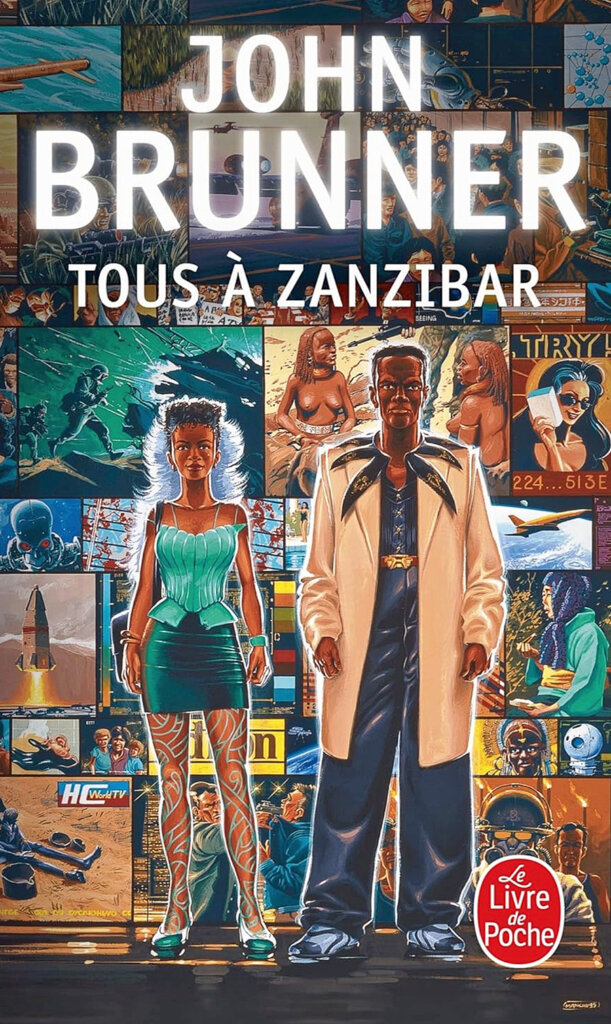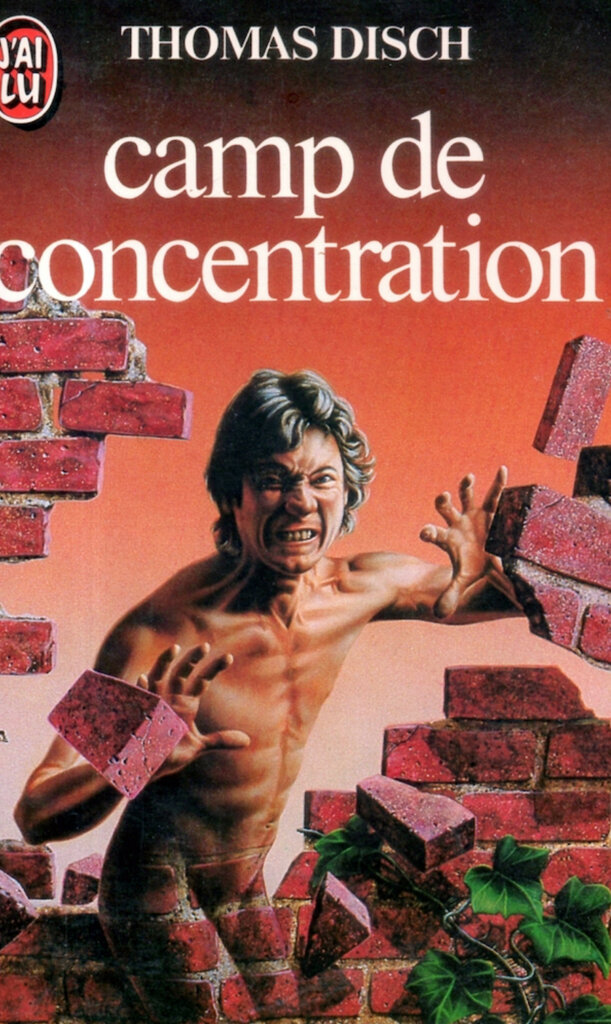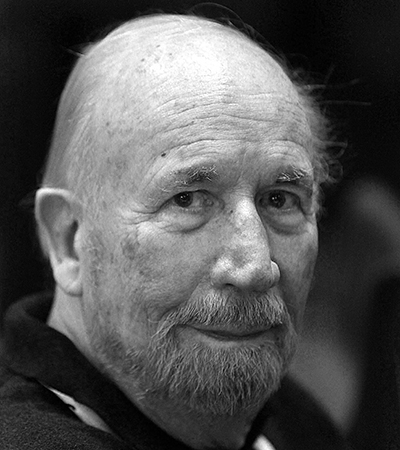
Philippe Curval — de son vrai nom Philippe Tronche — est bien connu de nos contrées pour avoir contribué au cours des années 1970 à l’émergence d’une science-fiction française de qualité en compagnie d’André Ruellan et de Michel Jeury, notamment au travers de titres comme L’Homme à rebours (Grand Prix de l’Imaginaire en 1975) ou Cette chère humanité (Prix Apollo en 1977). Auteur d’une quarantaine de romans et pas moins d’une centaine de nouvelles, il publie son dernier récit Idem’s en 2021, avant de nous quitter deux années plus tard, âgé de 94 ans. Il met également sa plume au service d’un appareil critique important, de « Fiction » à « Galaxie », en passant par « Le Monde » et « Le Magazine littéraire », poursuivant jusqu’à très récemment ce délicat exercice sur le blog partagé « Les Archives stellaires », hébergé chez nos confrères et éditeur Quarante-Deux. Pour le numéro 356 du « Magazine littéraire » paru en juillet/août 1997, numéro double consacré à la thématique de l’enfer, Philippe Curval revisite le sujet à l’aune de la littérature science-fictive au travers d’un texte fort généreux : « L’enfer : c’est l’avenir ». Le texte a fait l’objet d’une révision et d’une correction par l’auteur dans le cadre d’une publication pour la revue « Parallèles », avec l’aimable autorisation du « Magazine littéraire ».
L’enfer, c’est l’avenir,
Philippe Curval
Philippe Curval
In revue Parallèles, numéro 7, juillet 1998
A priori, l’enfer ne repose sur aucune donnée expérimentale ou scientifique. Nul physicien n’a prouvé son existence ni calculé ses dimensions. Même la théorie des quanta n’offre pas de système élémentaire qui permettrait de le définir. À partir des seuls atomes du soufre, les chimistes se sont avérés incapables de construire expérimentalement un univers plausible où vivraient les damnés. Quant aux géographes modernes, ils ne se risquent pas à situer son emplacement hypothétique sur notre planète entièrement explorée par les satellites. Pas de faille révélatrice dans l’histoire perpétuellement soumise à question. Avec les méthodes de calcul informatique, les sociologues les plus prospectifs demeurent impuissants à étudier une population de damnés qui échappe aux enquêtes d’opinion. « Ni les Écritures, ni la théologie ne nous fournissent les lumières suffisantes pour une représentation de l’au-delà », affirme l’Église depuis Jean Paul II.
C’est pourquoi l’enfer ne devrait pas concerner le champ de la science-fiction qui, selon des canons virtuels, anticipe à partir des faits objectifs, ou spécule à propos de leur interprétation. Même en considérant le thème infernal sous sa forme classique, voire archaïque, comme un objet conjectural, celui-ci n’offre guère a priori de projet littéraire pour un écrivain de S.F. Certes, l’épopée de Gilgamesh que certains considèrent comme le premier ouvrage du genre raconte une remontée des Enfers. Mais les utopies religieuses ne sont pas stimulantes que pour les croyants. Or, la tendance générale des auteurs du genre est à l’agnosticisme, sinon à l’athéisme ou au scepticisme éclairant. À moins qu’ils ne versent dans le mysticisme. Cette pulsion récurrente fait alors ranger leurs romans plutôt dans les catégories du fantastique ou de la fantaisie héroïque.
Néanmoins, tant que les écrivains ne seront pas parqués dans un camp disciplinaire, certains d’entre eux découvriront des biais pour échapper aux diktats spéculatifs. Car la mort reste un sujet valable. Le passage de vie à trépas laisse des preuves incontestables de sa valeur scientifique. Et, si le cadavre ne fournit aucune activité enregistrable, sauf celui de Jéhovah dans les romans de James Morrow, il est impossible de prouver, au besoin par l’absurde, que les défunts n’existent pas quelque part, dans un milieu et sous une forme à déterminer. Voilà qui excite l’imagination. « Le ciel et l’enfer, ce n’est jamais que de la Science-Fiction. Mais n’y a-t-il vraiment rien du tout après la mort ? » écrit Rudy Rucker, auteur vedette de la fin des années 1980, dans Maître de l’espace et du temps.
Parmi ceux qui se sont posé la question, un des rares exemples réussis de ce qu’on pourrait nommer la science-fiction théologique, mêlant avec adresse des éléments du folklore judéo-chrétien, et un réalisme spéculatif propre à la S.F. se retrouve dans Le Lendemain du Jugement dernier, de James Blish. Ce douloureux confiteor montre comment un occultiste matérialise sur terre tous les démons de l’enfer pour instaurer la troisième guerre mondiale.
L’un des plus anxieux se nomme Philip José Farmer. Dans un petit roman, L’Homme qui trahit la vie, il se demande ce qui adviendrait si l’on poursuivait son existence après la mort sous forme d’ondes électromagnétiques. D’après ses conclusions, l’ennui naîtrait un jour de l’uniformité. Suite à une seconde incursion dans le royaume des morts, intitulée L’Univers à l’envers, Farmer poursuit sa quête personnelle dans une fresque romanesque devenue classique, Le Monde du fleuve. Sur les bords d’un fleuve gigantesque, les morts de toutes les époques ressuscitent simultanément, adultes ou nouveau-nés, trente-cinq milliards d’individus, circoncis et chauves. La plupart retournent à leurs occupations une fois le choc digéré, d’autres décident de remonter jusqu’à l’origine du cours d’eau pour comprendre le sens de leur nouvelle existence. Parmi ceux-ci, Richard Burton, le célèbre explorateur, Goering, Mozart, Tom Mix. Le moins qu’on puisse dire, c’est que la suite de cette grandiose saga coule de source : après cinq volumes, les hommes se découvrent en même temps immortels, manipulés et impuissants à modifier les structures du destin, comme les choses de la vie. L’incapacité notoire de l’homo sapiens à évoluer définit les frontières de son enfer spécifique. Et lui interdit de supporter l’idée même d’un avenir dont le concept reposerait sur la cessation prochaine de la vie individuelle.
L’un des romans les plus talentueux, où se dessine d’une manière éclairante l’approche de l’enfer par les auteurs de Science-Fiction est certainement Ortog et les ténèbres de Kurt Steiner, alias André Ruellan.
À bord de sa nécronef, Dâl Ortog se rend dans « l’autre monde ». Nouvel Orphée, il s’y voit déjà installé, ainsi que la femme qu’il souhaite arracher aux ténèbres. « L’univers de la mort était peuplé d’êtres qu’un lien étrange rattachait à ceux de la Terre, vivants et morts. Quelle différence y avait-il entre ceux qui rappelaient les vivants et ceux qui rappelaient les morts ? Car il fallait qu’il y en eût une. L’inverse eût été incohérent… par “raison de symétrie”, on ne pouvait imaginer une vaste mixture irrationnelle. »
Même si les allusions abondent dans ce roman sur les incursions de célèbres écrivains au sein de l’Enfer, Virgile, Dante, pour l’auteur du Manuel du Savoir-mourir, spécialiste de la question, ce lieu ne saurait être seulement destiné au supplice des damnés, inventé par le christianisme, ni réservé au séjour des défunts, comme l’affirmait l’ensemble des civilisations antiques depuis le troisième millénaire. Puisque le projet de S.F. est de proposer des interrogations, des parcours parallèles, pas question d’effectuer une simple transposition ou de broder sur les thèmes éculés de la Divine Comédie. L’enfer sera scientifique et obéira à sa manière aux lois qui régissent l’univers. Ce qui incite Steiner à multiplier les situations énigmatiques, les créatures aberrantes et les paradoxes désespérés. Dans son esprit, l’empire de l’au-delà se visite surtout pour saisir les raisons de notre trépas, pour rompre la malédiction qui s’attache à notre sort terrestre, découvrir les moyens d’enrayer la mort, cette maladie. « Il est plus urgent de se soigner que de recueillir ses dernières volontés », écrit-il. Miroir inverse ou miroir déformé de notre monde, l’enfer renvoie une image qu’il faut décrypter. Et puisque le séjour des défunts comporte quatre dimensions, cela permet à ceux qui en franchissent les frontières de considérer les vivants comme des « êtres plats ». Une fois ceux-ci fixés commodément sous des lamelles de verre, il est aisé d’examiner au microscope leur mode de vie, leurs passions, leur dérèglement afin de saisir si leurs actes n’auraient pas une influence sur la qualité et la durée de leur existence. Mieux encore, de trouver une justification inconnue à leur parcours existentiel qui exclurait la mort.
Depuis cet Enfer dont Dâl Ortog triomphe, en devenant immortel et solitaire, son jugement s’affine sur l’univers des mortels ordinaires. S’ils ont la chance d’être plus vivants que morts, sans nul doute, leur existence ressemble plus à l’enfer que l’enfer n’y ressemble.
Robert Silverberg, dans Jusqu’aux portes de la vie, imagine que Gilgamesh, roi de Sumer, vaincu par la mort se retrouve dans un lieu gris, illimité, où tout n’est que magie et surnaturel. Là se côtoient les morts de tous les temps, Hommes Velus, Héros et Derniers morts issus de notre époque sans idéal. Prisonnier de sa propre histoire et condamné à y séjourner, Gilgamesh va chercher une porte de sortie vers l’univers des vivants. En la découvrant, il se retrouvera dans un New York contemporain dont la laideur et la cruauté lui sembleront plus atroces encore que les Enfers.
On voit se dessiner ici le point de vue général adopté par les auteurs de science-fiction lorsqu’ils abordent semblable thématique : apprécier la part infernale de notre réalité, spéculer sur les modalités de son devenir. Trois dominantes caractérisent ces œuvres, qui reproduisent l’évolution du genre d’une manière schématique, mais se croisent aussi tout au long de son histoire :
L’enfer, c’est les autres
L’enfer, c’est nous-mêmes
L’enfer, c’est l’avenir.
Bien sûr, ces Autres puisent bien peu au modèle sartrien — « Ah ! quelle plaisanterie. Pas besoin de gril, l’enfer, c’est les Autres. » —, exploité au pied de la lettre dans Métro pour l’enfer, de Vladimir Volkoff, prix Jules Verne en 1963. Non, ceux-ci sont identifiés malgré leurs ressources innées de Frégoli polymorphe : leur origine est d’abord extraterrestre. Depuis l’aube de l’humanité, les habitants de notre système solaire ou de la galaxie nous envahissent ou nous massacrent quand ils n’occupent pas nos corps ou nos esprits, comme dans Marionnettes humaines, de Robert Heinlein, un modèle cent fois exploité. Les tourments infernaux s’y présentent sous la forme d’une perte totale ou partielle de l’identité.
Si nous découvrons ces « Aliens », c’est la conquête et ses séquelles colonisatrices ou guerrières, dans le cas contraire, c’est l’invasion ; thème théoriquement plus propice à la description d’un enfer relatif lorsque les envahisseurs ne se livrent pas à la destruction radicale de la race humaine mais à son exploitation. Les plus affreux des extraterrestres les plus anciens se trouvent dans un roman redécouvert par Raymond Queneau, Star ou Psi de Cassiopée, de Defontenay qui date de 1854. Il ne s’agit pas des « défunts », mais des Morts, créatures qui ressemblent à des outres difformes et se nourrissent des principes vitaux des autres espèces qui peuplent leur système solaire. Pourtant, à part leur nom évocateur, ces derniers ne sortent pas de l’enfer pour nous tourmenter.
C’est H. G. Wells, avec La Guerre des mondes, qui introduit le premier l’idée des envahisseurs démoniaques, martiens en l’occurrence, déterminés à transformer notre planète en séjour infernal. Leur descendance nombreuse envahira la Science-Fiction primitive en France comme dans les pays anglo-saxons, encombrera les couvertures de romans bon marché et autres magazines populaires des années 1920-1930. Dans un grand nombre de récits, ces êtres malfaisants venus d’outre-monde ne seront exploités qu’afin d’emplir les pages de batailles galactiques interminables et réellement sans intérêt dont la descendance résolument manichéenne se retrouve dans le cinéma actuel, de Star Wars au Cinquième élément. Dans le meilleur des cas, elles serviront de métaphores pour traduire les tabous qui nous inhibent, l’exclusion, le racisme, l’incompréhension entre les êtres, ou d’objet pour une véritable spéculation sur des formes de vie différente. Mais ces hordes de monstres terrifiants, reflets de nos terreurs intimes devant la mort et la souffrance, vont aussi s’acharner à construire des enfers sur Terre, avec des raffinements sataniques dont la liste n’est pas close. Parmi ceux-ci, bien peu, hélas, sont d’essence métaphysique. Ils empruntent aux mythes infernaux leurs supplices les plus triviaux, en fouillant l’homme dans sa chair avec des armes laser plutôt qu’avec de l’imagination. Malgré les découvertes de la haute technologie spatiale, ils continuent à nous faire bouillir dans la poix, noircir dans la suie de feux infernaux, à nous embrocher, gaver de plomb fondu, clouer sur une herse chargée de roches. Quand ils ne nous mangent pas en sauce, à la manière des envahisseurs de Comment servir l’homme, de Damon Knight.
Il faudra attendre la relève des années 1950 pour que des écrivains inspirés, Robert Sheckley par exemple, peaufinent des extraterrestres et des enfers plus sophistiqués. « Toute chose cesse d’être drôle quand elle s’assoit sur vous », résume ce subtil humoriste à propos des situations qui se retournent en défaveur de l’homme quand il cherche à prendre le pas sur d’autres races galactiques. La malveillance des Autres est d’essence satanique. Et, si les enfers de Sheckley sont minuscules et ne concernent apparemment que quelques aventuriers sans scrupule, ils comportent de cruels raffinements. Une poudre grise par exemple, qui se répand à la surface de toute la planète, ensevelit êtres et choses, dont on ne peut stopper le déversement sans découvrir l’introuvable clé Laxienne. Ces cendres de l’enfer provoquent une damnation éternelle que ni Kafka ni les Marx Brothers ne renieraient.
Dans Le Temps meurtrier, le même Sheckley imagine aussi un au-delà scientifique où règnent les docteurs de la Société. On y croise quotidiennement des zombis, des vendeurs d’âme, des fantômes. Avec Le Prix du danger, il suggèrera que le démon suprême peut être la télévision, créatrice d’émissions infernales où le téléspectateur est supplicié jusqu’à mettre sa santé mentale en péril et sa vie à l’écran. Par ce texte prémonitoire, il est devenu le premier écrivain à décrire l’enfer du pixel.
Car les Autres, en S.F., ne se limitent pas aux extraterrestres et prennent les formes les plus diverses, voire les plus abstraites. Ils poursuivent les mêmes ambitions perverses sous l’apparence d’insectes d’origine indigène, termites ou fourmis par exemple, qui chercheront à nous imposer de vivre au sein de leur société totalitaire, comme dans ce très angoissant roman d’A. Gordon-Bennett, Les Demi-Dieux. Ils adoptent volontiers le visage d’innombrables savants fous dont l’ambition démoniaque sera tout entière vouée à provoquer des situations à l’image de leur frénésie destructrice, symboles d’une révolte d’essence satanique contre la création. Sans compter les créatures chtoniennes, qui appartiennent de tout temps aux enfers et qui reviennent nous hanter, nous menacer du retour à la géhenne primitive. Même les Grands Anciens de H.P. Lovecraft, maître absolu de la Science-Fiction ténébreuse, iront jusqu’à créer l’homme en laboratoire, dans Les Montagnes hallucinées, pour s’amuser de lui et jouir de sa souffrance.
Dans la S.F. actuelle, la vision démoniaque de l’Autre s’est humanisée, avant de passer de mode. Quand celle-ci ne se transforme pas, à travers le thème du double, en une version ambiguë de « l’enfer c’est nous-mêmes ».
Demeurent quelques figures sataniques originales, tel le Gritche inventé par Dan Simmons, dans Hypérion. Cette créature barbare et mystérieuse hérissée de lames et de mâchoires bioniques fait, par son seul nom, régner l’épouvante. Révérée par l’église des Templiers et protégée par les Tombeaux du temps, cette entité constitue la seule énigme universelle dont la présence s’oppose à la toute-puissance de l’Hégémonie, à l’invasion des Extros, aux sournoises manœuvres des Intelligences artificielles. Obscurément, elle se présente comme le dernier rempart contre l’enfer moderne, celui que nous construisons à coup férir (fait rire) grâce au progrès idéologique, sociologique, scientifique et technologique.
Ceci induit qu’en S.F., l’enfer symbolise surtout l’effet retour que produit l’humanité moderniste en s’efforçant de transformer le réel. L’enfer « climatisé » selon la définition d’Henry Miller. « Les théologiens d’antan discutaient pour savoir si l’enfer avait été créé par Dieu ou le Diable. Dommage qu’ils ne soient plus en vie pour recevoir une réponse à leur question. L’Enfer existait bel et bien, et c’est General Motors qui l’avait créé », a écrit Robert Bloch dans La Fourmilière.
L’origine de cette constellation politique des sociétés humaines et de leur diabolisation est ancienne, elle s’incarne dans la contre-utopie, voire l’uchronie. Déjà Émile Souvestre en 1845, dans Le Monde tel qu’il sera, décrivait l’apparition d’un monde aberrant, uniformisé, produit par la révolution industrielle. Cauchemar réaliste issu de la crainte du « Progrès », envisagé comme un moyen de réduction des valeurs humanistes, mais aussi des valeurs tribales.
Wells, encore et toujours, catalysera ces peurs en un magistral roman, Quand le Dormeur s’éveillera, fondateur de la contre-utopie moderne qui produira tant de nouveaux mythes infernaux. À sa suite, dans les années 1920, paraîtront Nous autres, de Zamiatine, Metropolis, dont Fritz Lang fit un film d’anthologie, Le Meilleur des mondes d’Huxley en 1932 et 1984 d’Orwell en 1949. « Big Brother » n’épargne pas les mémoires de ceux qui se sont retrouvés dans les pages où sévit son organisation totalitaire. Cette idée que la recherche de la perfection et du bonheur à tout prix entraîne la perdition des hommes et leur soumission à des enfers qu’ils administrent eux-mêmes, puise au concept même de la damnation, proche parent du péché originel. On le sait, en croquant le fruit de la connaissance, Ève, le premier clone, nous a chassés du paradis.
Hiroshima est venu à point pour prouver que l’Enfer peut exister sur terre quand les hommes se mêlent de l’inventer. Son feu a consumé en un beau nuage ardent le mythe du progrès scientifique apportant félicité, plaisir et prospérité. Même si ses flammes n’ont duré qu’un temps très bref, elles ont ravagé la cité et plongé les irradiés au sein de la mort lente. Ce symbole fort va gangrener la S.F. dans son ensemble. Désormais la septicémie écologique contamine la spéculation.
Le nombre de romans post-atomiques va augmenter d’autant, constituer le terreau d’une littérature de S.F. « no future » ou s’exprimera le constat d’une désillusion planétaire sur les capacités de s’extirper du bourbier existentiel grâce aux avancées de la technologie.
Jusqu’alors, dans les romans d’anticipation post-cataclysmiques portant sur la fin du monde, la mort de la Terre, les épidémies nouvelles, la sécheresse ou le déluge, le choc d’une comète, etc., avanies à la suite desquelles l’humanité périt ou involue, la cause est attribuée soit au fatum, soit à une punition d’ordre divin. Du Déluge futur (1911), de Marcel Roland, au Monde englouti (1962) de Jim Ballard, la différence de traitement romanesque tient dans les nuances du comportement humain face au cataclysme. Avec Le Diable l’emporte, de Barjavel (1948), l’adversaire est clairement désigné, le grand Satan, c’est l’homme, qui construit ses propres enfers en guerroyant, le vrai créateur de l’épouvante infernale.
Ce terrible constat, Bernard Wolfe va le pousser jusqu’à ses extrêmes conséquences dans l’une des œuvres les plus puissantes, foisonnantes, de toute la Science-Fiction contemporaine, Limbo. Après la troisième guerre mondiale, les écrits du docteur Martine sur les blessés poussent l’un de ses disciples à créer l’Immob, une doctrine qui prêche l’immobilité, suprême espoir de l’homme. Deux sectes s’opposent sur son interprétation. Les premiers se multiplient et remplacent leurs membres par des prothèses. Les seconds prêchent le retour au stade fœtal. Cet affrontement aboutit à la quatrième guerre mondiale. Quand elle atteint pareille perfection, l’observation clinique de l’absurdité des aberrations humaines procure un plaisir rare à l’amateur d’enfer organique.
Jean-Pierre Andrevon, dans Le Désert du monde (1977), va exprimer cette situation jusqu’à la quintessence. Un homme se réveille nu, au sein d’un village où la réalité n’a pas fait le plein. Il est seul et ne se souvient de rien. Est-il mort, est-il damné ? Ce n’est qu’un leurre déposé par des extraterrestres pour savoir comment vivaient les humains, avant la fin. « Qu’est-il besoin d’aller chercher l’enfer dans l’autre vie ? Il est dès celle-ci dans le cœur des méchants », disait déjà Rousseau dans l’Émile.
Mais cette question et sa réponse ne règlent pas le sort de l’homme après la mort pour autant. Et les destructions massives que ce dernier inflige à sa planète pour affirmer sa douleur existentielle ne sont qu’une des formes les plus élémentaires de protestation contre la condition humaine. Les auteurs de S.F. savent aussi inventer des situations démoniaques plus raffinées, en particulier dans les romans qui traitent de la surpopulation. Après Tous à Zanzibar, le chef-d’œuvre de John Brunner, Robert Silverberg a construit, avec Les Monades urbaines, un système concentrationnaire imparable : vaste pandémonium qui comporte des tours d’habitation de 1 000 étages pour une population terrestre qui atteint soixante-quinze milliards d’habitants au XXIVe siècle. D’où une implosion lente des rapports affectifs qui dissout sans appel les structures de la société et conduit à l’enfer ordinaire. Plus terrifiante encore est la condition que réserve Michael Coney à nos descendants : la planète est tellement surpeuplée qu’il est nécessaire de sauvegarder les cerveaux en boîte, si quelques-uns veulent encore respirer. La seule solution est d’obtenir un corps provisoire pour sortir de l’enfer en conserve.
Au début des années 1970, la fiction spéculative, genre nouvellement apparu, ouvre des voies étranges à la S.F. Leurs auteurs découvrent les moyens d’entretenir l’illusion infernale de notre survie en identifiant, puis en isolant nos pulsions mortifères pour les transcender. Cette mise en abîme systématique de la condition humaine produit des textes souvent cryptés. Mondes idéalement clos qui offrent les meilleures perspectives sur nos enfers intérieurs, créés par le principe d’autodamnation de nos sociétés contemporaines.
Christopher Priest est l’auteur du plus surprenant d’entre tous, Le Monde inverti. Dans Cité-Terre, on mesure l’âge en kilomètres et on divise l’espace entre passé et futur ; c’est que la ville doit rouler sans cesse, sur des rails qu’on démonte derrière elle pour les remonter devant, afin de se maintenir vers l’Optimum. De terribles distorsions affectent êtres et choses, temps et espace, de part et d’autre de la route. Qu’importe, le cap doit être maintenu. Jusqu’au jour où ses habitants découvriront l’immensité de leur folie. Cela les découragera-t-il de persister dans l’erreur ?
« Chaque jour vers l’Enfer nous descendons d’un pas,
Sans horreur, à travers des ténèbres qui puent. », disait Baudelaire.
Je mentionnerai pour mémoire Cette chère Humanité où je décris en 1975 l’avènement d’une Europe en proie à ses démons, le jour où celle-ci aura chassé tous les étrangers et cadenassé ses frontières pour vivre en circuit fermé, dans l’autisme absolu créé par la communication audiovisuelle et l’infernale irruption du contact virtuel.
Dans Camp de concentration, de Thomas Dish, un régime militariste et fascisant enferme les intellectuels à Camp Archimède, aux États-Unis en guerre dans un futur proche. Ils sont soumis à l’action d’un sérum obtenu à partir de l’agent vecteur de la syphilis qui favorise leur production cérébrale, mais les mine et les condamne à mort à brève échéance. L’approche du génie conduit progressivement un jeune poète à se fondre à ses hantises.
Chez Antoine Volodine, les Enfers fabuleux participent au voyage spatial. Ce dernier est l’enjeu de puissances occultes, en particulier des très curieux mutants. Ils s’amusent, on dirait, à faire flamber des innocents pour vérifier si l’holocauste constitue bien un moyen de vaincre les dimensions.
Dans Ubik, si les choses semblent fonctionner avec peine pour les vivants, les morts sont mis à contribution pour tenter de maintenir une apparence de réalité.
« C’est difficile à expliquer, mais il y a longtemps que je le fais avec des tas de gens », dit l’un des personnages de Philip K. Dock. « Je mange leur vie ou ce qu’il en reste. Il y en a très peu en chaque personne, alors il me faut beaucoup de gens… Si vous venez écouter près de moi — je garde la bouche ouverte — vous pourrez entendre leurs voix. » Ce Jory, qui a créé 1992, ne parvient pas à consommer assez d’énergie pour maintenir l’illusion ; les choses commencent à se détraquer, les pièces de monnaie, les cigarettes. Les années régressent jusqu’en 1939. Car il se produit des interférences entre cet univers dégradé et l’univers onirique des morts conservés en semi-vie dans des cercueils cryogéniques. Seul Ubik connaît la fin de l’histoire, car il est partout. Mais qu’est-ce qu’Ubik ?
Pour échapper à ces tartares, ne suffirait-il pas d’adopter une manière de vivre qui n’accorderait pas grand crédit au réel, décidément fort décevant pour un amateur de confort existentiel ? Par exemple en se dédoublant pour ignorer sa part la plus néfaste. Ainsi aboutit-on à la création d’enfers encore plus subtils.
Dans Substance mort, le même Dick décrit la vie quotidienne d’un groupe de marginaux qui refusent la société en se défonçant avec toutes les drogues, surtout la plus terrible, la substance-mort qui détruit le cerveau et dédouble la personnalité. Le résultat s’avère effrayant pour Fred qui travaille à la brigade des stupéfiants, en même temps qu’il joue le rôle de Bob, un toxicomane avarié dont il assume la filature. L’enfer, c’est lui-même.
À travers cette dissolution des certitudes sur laquelle repose notre appréciation de la condition humaine, de sa vraisemblance, se dessine la figure majeure de ces spéculations, l’Entropie, assimilée à l’enfer. Elle frappe inaltérablement là où il y a vie, énergie, et condamne toutes nos actions, nos pensées à l’oubli éternel. Plutôt expirer que de continuer à penser que nous disparaîtrons par défaut. C’est l’enfer par inadvertance où s’engloutissent tous les principes moraux, les religions, les idéaux, les créations de l’intelligence. Ce néant reproduit à l’échelle du cosmos donne une piètre idée de l’éternité, réduit à la portion congrue les visions les plus exaltantes des prospecteurs du futur. D’où une réputation infernale qui s’attache de tout temps à la S.F.
« L’ennui avec la science-fiction, c’est qu’elle m’ennuie à mourir », dit Jacqueline Bisset. « Je me suis endormi devant la télévision, le jour où les hommes ont pris pied sur la Lune », raconte Patrick Laffont. « Je m’efforce de ne jamais lire de science-fiction, car je tiens à protéger la pureté de mes visions », affirme le mage Belline. « Je ne peux pas en lire, ça m’angoisse à tel point que ça me rend malade », dit Alice Sapritch ; à peu près ce que répondent Carita et Michèle Morgan. « La science-fiction, c’est l’horreur derrière la porte. Mais je ne l’ouvre jamais, j’ai des domestiques pour ça », prétend Karl Lagerfeld. « 2001, l’Odyssey de l’espace me laisse un souvenir de somnolence immobile et multicolore », conclut François Nourrissier au questionnaire provisoire sur la S.F., proposé par I. & G. Bogdanoff dans L’Effet science-fiction, livre mémorable peu connu. Ce bref pot-pourri de réponses fournies par un échantillon assez représentatif de l’intelligentsia française offre un remarquable panorama fantasmatique des terreurs qu’elle engendre, des catatonies, des perturbations mentales qu’elle produit.
La plupart des humains renoncent pourtant à leurs peurs à partir du moment où les inventions nouvelles qui déferlent sur nos sociétés depuis l’aube du XIXe siècle entrent dans le champ du vécu, s’apprivoisent.
Curieusement, lorsque la science-fiction s’insère dans la réalité, lorsque les hypothèses qu’émettent ses auteurs imprègnent les mœurs, que ses interrogations spéculatives passent dans le domaine des faits, il se trouve rarement commentateur pour le souligner. Dans le meilleur des cas, l’opinion s’exprime par une phrase magique ; véritable rituel de désenvoûtement. « Ce n’est plus de la science-fiction ! » qui implique un vrai soulagement de la part de celui qui le prononce. Cette expression signifie qu’un grand pas vient d’être accompli par l’humanité. Désormais un nouveau pan de réalités s’est dévoilé. Finies les rêveries, les errances. Une manière de nier que la science-fiction dans son ensemble puisse jouer le moindre rôle prospectif, favoriser l’émergence de certaines inventions, éclairer l’opinion sur les orientations d’un monde en devenir. Bref, accomplir le travail fondamental sur l’inconscient collectif qu’elle réalise depuis plus d’un siècle à travers ses œuvres majeures.
Mais le progrès technologique et scientifique relance sans cesse l’imagination des auteurs de fiction spéculative, contraint les hommes à envisager d’autres métamorphoses de civilisation qui s’annoncent et déjà suscitent l’effroi, font surgir les lendemains qui déchantent, se lever les boucliers de l’indignation réactionnaire.
Pour la majorité des humains, l’horreur du changement va de pair avec la peur de l’avenir. Soit l’Enfer authentique. Un lieu où personne n’aimerait séjourner. L’objet principal de la science-fiction consiste à l’explorer en attendant qu’il se transforme au mieux en purgatoire, rarement en paradis.
Vidéos
Philippe Curval et Bernard Pivot. Actu Litté.
Science-fiction, athéisme et religion. Mumons.